On ne voit plus Van Gogh. Ni l’homme, ni la peinture, effacés derrières les mythes qui se sont construits par-devant. Et cela simplement justifie que l’on y revienne.
L’essai biographique serait alors de l’ordre d’une restauration, travaillant à faire resurgir sous la patine du temps et les opacités ou réductions auxquelles on a fini par s’accoutumer et auxquelles notre regard fini par se conforter, la réalité d’une œuvre.
Que l’on jette pêle-mêle une variété confuse de choses par derrière le mot folie ou qu’on le fasse semblablement derrière le mot génie auquel il s’est souvent confondu, cela est un même expédiant, une manière économique de juger d’une vie et de l’œuvre à laquelle elle s’est mêlée, d’un parcours. Soyons incisifs : une manière de l’occulter. On se refuse à penser les êtres dont on fait des légendes, des mythes, comme de ceux dont on fait des étrangers absolus. C’est comme de nier leur existence, leur vie parmi nous pour les soumettre à nos désirs, à nos fictions, leur faire jouer des rôles dans les représentations fausses toujours plus pauvres que la réalité. S’empêcher de voir et de comprendre.
A cette façon caractéristique du XIXème siècle qui, tellement avide de mystères, fini par placer l’œuvre derrière la biographie et les fantasmes qu’elle suscite, Philippe Blanchon oppose la primauté de l’œuvre. Œuvre qui frappe et subjugue quelque soient les qualificatifs auxquels on voudrait la soumettre, les obscurités en lesquelles on voudrait la voir prise. C’est un jugement très sommaire et tellement partagé de croire qu’un artiste pour qu’il soit véritable doive nécessairement être assujetti à une forme de folie géniale qui manifeste sa situation d’étranger parmi les hommes. Montaigne en son temps en répondait quand il s’agissait là aussi d’occulter la simple réalité des différences derrière les termes de barbare et de sauvage : « or, je trouve, pour revenir à mon propos qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation…sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage”.
Evitant les impasses auxquelles mène aujourd’hui toute tentative de diagnostique médical rétrospectif (entendons le médecin qui le suit à Saint Rémy confier aux inquiétudes de Théo : Vincent est un « simple patient » nerveusement à bout, épuisé, surexcité par ses recherches – non pas un cas !), Philippe Blanchon revient sur le parcours de l’homme, ce qui l’a amené à former son œil et son esprit et cet invraisemblable mélange d’obstination et d’exigence qui le jetait au travail malgré la fatigue nerveuse et physique, l’adversité, l’usure à laquelle il se soumettait. Sans doute est-ce cela que d’autres appelleront folie, simplement quelque chose qui n’est pas de leur usage.
Partant de son abondante correspondance et de quelques témoignages directs, il retrace quelle fut sa vie, de l’expérience de prédicateur laïque en milieu ouvrier au commerce de tableaux avec son oncle jusqu’à cet irrépressible recours à la peinture, son apprentissage méthodique, ses premières déconvenues, les humiliations successives qu’il essuie. Qu’une vie normale, affectivement équilibrée, que la reconnaissance de son travail lui soient perpétuellement refusées -désirs somme toute très communs- les dettes qu’il accumule auprès de son frère bienveillant et qu’il comprend qu’il ne pourra solder, la solitude terrible à laquelle il est soumis, l’échec du grand atelier du midi ne pouvaient qu’engendrer les terribles épisodes dépressifs qui l’ont accablé. Son tempérament est trop entier pour qu’il ne prenne pas tout cela de plein fouet.
Ici, derrière la figure idéale, Blanchon cherche à retrouver l’homme, rendant les difficultés et accablements qui furent les siens et que l’on voudrait voir l’exclusive des « artistes maudits » à leur réalité malheureusement ordinaire. « Ce dont Van Gogh a souffert, beaucoup d’hommes en souffrent ». Van Gogh n’est pas dans la quête d’une originalité élaborée, il fuit plutôt la vie étouffante des cercles artistiques (Blanchon cite à cet égard Juan Gris : « Toute manifestation voulue de la personnalité est la négation même de la personnalité. »), sa peinture n’est pas la manifestation esthétique d’une quelconque pathologie mais le fruit d’un travail conscient, élaboré, réfléchi et cultivé (que l’on n’oublie pas que Van Gogh écrit et parle trois langues, lit énormément et manifeste une grande curiosité pour des artistes très divers, il n’a rien d’un ermite étranger à la culture de son temps, d’un naïf ou d’un prétendant à la rubrique de l’art brut). Un peintre sujet à des épisodes psychotiques, Gérard Garouste, l’a répété plusieurs fois : ses délires ne nourrissent pas sa peinture, ils l’empêchent régulièrement de peindre. Que l’on ne dise plus que la souffrance est le terreau de l’art, l’ambition esthétique et l’exigence des artistes sollicitent bien assez leurs ressources pour que l’on réclame double peine en les soumettant à l’ignoble carte postale romantique. C’est sans doute, pour Blanchon, ce malentendu qui aura contribué à ce que Van Gogh s’éclipse prématurément. Lui l’humble artisan de son art, au regard intense, travailleur altruiste avide de beauté et d’équilibre, accablé par le malentendu d’un critique qui le présente comme un artiste « percevant des intensités anormales », des « nuances invisibles aux prunelles saines », des « excès » et une « violence d’expression ». Ultime incompréhension qui scelle l’impasse. « Devenir Van Gogh, au sens social du terme – supposant un mensonge majeur – ne pouvait-il se produire qu’en sa totale absence ? » se demande l’auteur.
Van Gogh n’est pas grand d’avoir acquis une popularité post mortem du fait de ses souffrances, de sa supposée folie. Il n’est pas grand du fait d’un sentiment de culpabilité sociale, de remords contaminant la mémoire collective pour se manifester sous la forme financière d’un côte faramineuse, il est monumental pour ce qu’il a accompli et qui nous échappe définitivement dans ce que nouent singulièrement les mouvements de sa touche, la luminosité de ses couleurs, la vigueur de son dessin. D’avoir réalisé ce qu’il a réalisé. Ceci est sans doute « la victoire » de Van Gogh. Nul doute que ceci à quoi il s’est brûlé, il voulait l’offrir aux autres, lui qui voulait faire une peinture « consolante comme une musique » et atteindre cet infini qu’il voyait au fond des yeux des hommes, fidèle à ses élans premiers de « prêtre ouvrier ».
Philippe Blanchon, La victoire de Van Gogh, éditions Golias juin 2013.
et aussi
Van Gogh, Lettres à Emile Bernard, préface de Philippe Blanchon, éditions La Nerthe, mai 2013.
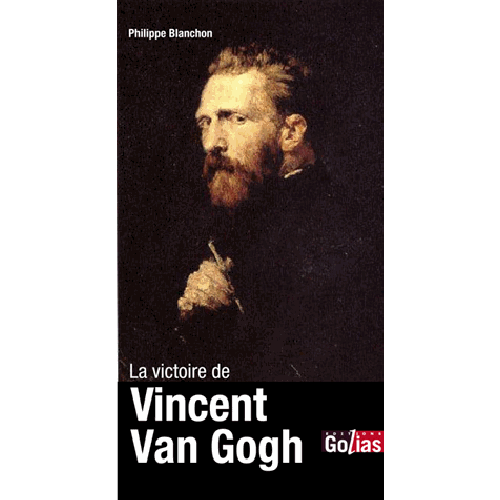
0 commentaires