Chaque siècle son affection. Un mal dont on ne sait s’il est généré par l’époque et les nouveaux modes d’existence qu’elle produit, si elle l’invente ou se rend simplement capable de le voir en le nommant, le désignant, l’identifiant. N’y avait-il rien de comparable au siècle dernier en occident à ce que l’on nomme aujourd’hui d’après le roman publié en 1961 par Graham Greene « burn-out » pour qu’aujourd’hui il incarne le revers des modes de vie contemporains, les dérives de sociétés ayant vendu leur âme à la production, à la mécanisation, au rendement et à la croissance, le visage enfin de la fatigue d’une civilisation?
Combien autour de nous pour témoigner de cette brisure dans leur vie, avec séquelles persistantes parfois, abattement durable ? Combien avec quelque chose de brûlé et cette manière ensuite d’être là sans y être ?
Harold Bradley en 1969, puis Freudenberger au début des années 70 définissent cet état de stresse aboutissant à une forme de dépression (le mot est à entendre littéralement) comme une sorte de combustion provoquant un effondrement des structures intérieures. Un effondrement laissant l’apparence intacte mais creusée d’un vide, sans plus rien qui la porte. En France on dit « syndrome d’épuisement professionnel ». Une fatigue profonde, un sentiment d’échec qui laminent la volonté.
« En février 2014, à la suite d’un burn-out, Cécile Portier entre pour trois semaines en clinique psychiatrique ». Ainsi, Pierre Ménard introduit-il dans sa préface le livre que l’on va lire qui lui ne dira que la scène ou l’espace vaguement circulaire, « le temps qui passe en spirale, en entrelacs, en rond, en n’importe quelle forme qui ne soit ni droite ni orientée ». Cet espace dans lequel on rentre quand la vie que l’on mène vous éjecte d’elle-même. Ces « lieux de fatigue » ou règnent les petites activités routinières et les « longs silences ». Elle note alors. Comme pour se le dire à soi-même. Là où elle est, ce qui s’y passe, comment on y est, ou l’étrangeté mole de cette expérience que c’est d’échapper soudain à l’aspiration des ces vies modernes, hyperactives que l’on mène pour l’éteindre là dans ces chambres de décompression. Et puis les autres dans ce qui les rapproche et leurs histoires propres. Comme en aparté ou le regard qui tombe sur un qui passe, entre parenthèse, le cas ou la figure de « celles qui sont assises en tailleurs au milieu d’un pelouse », « celle qui dit : moi c’est l’élan vital, c’est difficile de retrouver l’élan vital », « celui qui dit : on a chacun notre histoire », « celui emmuré qui depuis le début du repas se taisait et qui tout à trac dit, moi j’ai tout perdu ! Puis se tait. On lui demande, on lui dit : explique. Il répète : j’ai tout perdu ». « Celui assis silencieux sur un fauteuil depuis de longues minutes, et qui dit tout à coup : purée mais qu’est-ce qui m’arrive ? ». Au plus proche de la détresse et dans ce qu’elle revêt aussi d’ordinaire et qui la rend plus sourde encore, plus désespérée. La gentillesse et la douceur, les attentions infimes par lesquelles chacun se préserve.
On en riait de Charlot resserrant mécaniquement les boulons et pris par le geste jusqu’à la folie, Buster Keaton désossant la locomotive. De cette absurdité cocasse. « Il continue et avance très vite mais au prix de tout dévaster ». J’avais noté pour moi la définition que faisait Canguilhem du pathologique : exemple : quand l’estomac se digère lui-même.
Or nous en sommes là. L’épuisement des ressources naturelles, la pollution, la paupérisation, la financiarisation, l’agriculture, l’abattage intensifs, l’usure des êtres se tuant à gagner leur vie, l’anthropocène. J’entendais un reportage où le nouveau président américain annonçait vouloir intensifier l’exploitation du gaz de schiste malgré les témoignages sanitaires alarmant, les familles s’empoisonnant de ce que l’eau qui coule de leur robinet s’enflamme certains jours, le drame écologique. D’autres s’en réjouissant, considérant avec lui qu’ils étaient assis sur une manne qui représentait des millions de dollars et qu’il fallait en profiter maintenant tant qu’on pouvait. Une vision très courte, très étroite, irresponsable. Incapable d’envisager autre chose comme horizon, comme moteur de ses actions qu’un profit immédiat en dollars, occultant le prix exorbitant qu’elle réclame. « Prenons le fric et tirons-nous ». Une naïveté d’enfant qui aurait ingurgité trop de feuilletons télé. Mais victimes eux aussi : « nous devons obéir à des ordres qui se font passer pour l’ordre des choses. Nous échouons. (…) nous ne savons pas détourner les ordres, et leur violence, sur d’autres corps que le nôtre », note Cécile Portier. « Nous voyons comme nous sommes joués. Floués, endettés. Nous ne savons pas à qui, à quoi nous appartenons. De nos vies nous ne voyons que les mécanismes. » « Il faut dire, les mécanismes sont conçus pour se mouvoir, nous émouvoir. Pensez à la meule, comme elle nous attendrit. Les engrenages s’enclenchent à l’eau qui coule et ne revient jamais, et en transmission perpendiculaire autour de dents parfaitement calibrées, font que tout tourne et nous broie (…) nous appelons ça : les circonstances extérieures ». Alors elle note encore : « celui qui répète, qu’est-ce qu’on va devenir, qu’est-ce qu’on va devenir. Et ce n’est pas une question ».
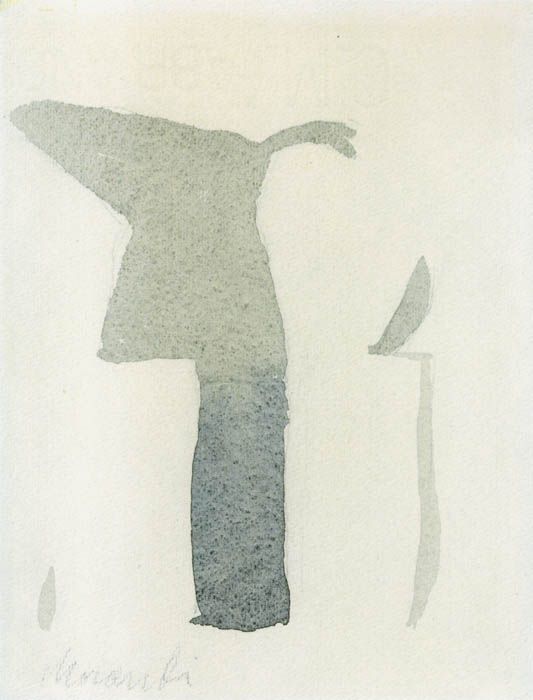
0 commentaires