On imagine très bien Armand Dupuy dans le matin calme et frais, tout encore pris de sommeil (« respirations lentes à l’étage »), attablé dans la cuisine, le chauffage d’appoint certains jours, la nuque tantôt cassée sur ses feuillets, sur un petit carnet de notes, tantôt prise d’un élan, le regard loin, confronté à l’exercice d’écrire, de poser des mots, des phrases brisées, en miroir de ce qui par la fenêtre, dans un morceau de terre, un mur, les traces qu’il peut y lire, manifeste à cet instant le monde. Porté par ce qui travaille l’obscurité de la tête, le regard joue d’un battement d’ailes dans son désir de ciel (« l’oiseau, toujours pour le fragile et l’immense »), d’une certaine légèreté porteuse, retombe, rattrapé par la matité sourde de la feuille, le poids des mots qu’il traîne, la nécessité d’inventer pour chaque instant, chaque chose sa langue – ajuster la langue à l’objet. Ou faire jouer cette petite musique en dessous du sens qu’évoque quelque part Darwin et qui restitue au sens sa vie, sa vibration, son souffle. Au départ, on pourrait bien envisager un petit tableau impressionniste. Tenter de dire le mieux possible, de la manière la plus juste la perception d’un instant, la lumière sur la table qui est là simplement sous le regard depuis la fenêtre et sur la table, au milieu de la cuisine et puis comment elle joue du baromètre intérieur. Restituer ce par quoi les choses se donnent telles à soi un certain moment. Toucher à ces petites choses, en épouser quelque chose, en respirer le volume serait déjà beaucoup. On se rappelle ces témoignages de Giacometti s’escrimant à un crâne, à une tête, une pomme au cours de séances répétées, tentant de rendre la présence de l’objet dans son espace, désespérant de ne pas parvenir à accorder déjà les parties d’un visage, accroche du nez, orbites. Cézanne retenu au cours de ses ballades sur le motif par cette masse obsédante de la montagne Sainte Victoire, toujours semblable et toujours offrant un aspect nouveau un peu comme enfant on croirait que le soleil à le constater toujours au dessus de soi vous suit. Et puis tout se complique : les moyens mis en jeu par l’observation se confondent ou influent sur ce qui est observé et on ne sait plus bien à quoi l’on est. On fini par regarder le fond de notre tête, comme l’écrit quelque part Bernard Noël. Nicolas Pesquès le note, à son propre motif : « la colline n’est pas indépendante de son observateur, ni même de son observation ». Et encore : « Il y a cela sur quoi je ne peux pas mettre le doigt parce que le mot déclenche l’insaisissabilité. Il y a cela que la langue fait paraître et repousse. » Sait-on dire l’état, la présence, la simplicité après avoir passé des siècle à décrire des batailles mythiques, des miracles, des agitations ? Sait-on dire le rien de l’ordinaire sinon par la buttée bête ? « On regarde, la pièce ne passe pas dans la phrase, les murs trop lourds tiennent bon ». « On tire à soi cette terre et l’on demande comment dans si peu tenir, si seul et cousu ». Dans son obstination à revenir chaque matin à ces choses, le sentiment de ne pas être à la hauteur. « Reste toujours ce roc, ce truc qui jamais ne casse ». « Dire ne dénoue rien ne desserre rien ». Butte. Ça échappe au bout des yeux, au bout des doigts, au bout de la langue ou de ces mouvements de tête par lesquels on tente. On ne sait sans doute pas même pourquoi le regard va par-là, ce que l’on pourrait en retirer, où ça porte, quel en est l’enjeu. « On avance dans la confusion, mais pas tout à fait perdu ». Retenu par quelque étroitesse, incapacité, avançant « sans franchir », mais avançant quand-même.
Armand Dupuy, Sans franchir, éditions faï-fioc.
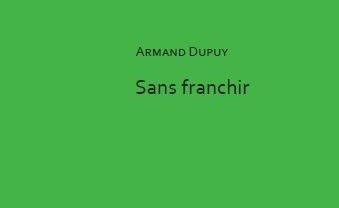
0 commentaires