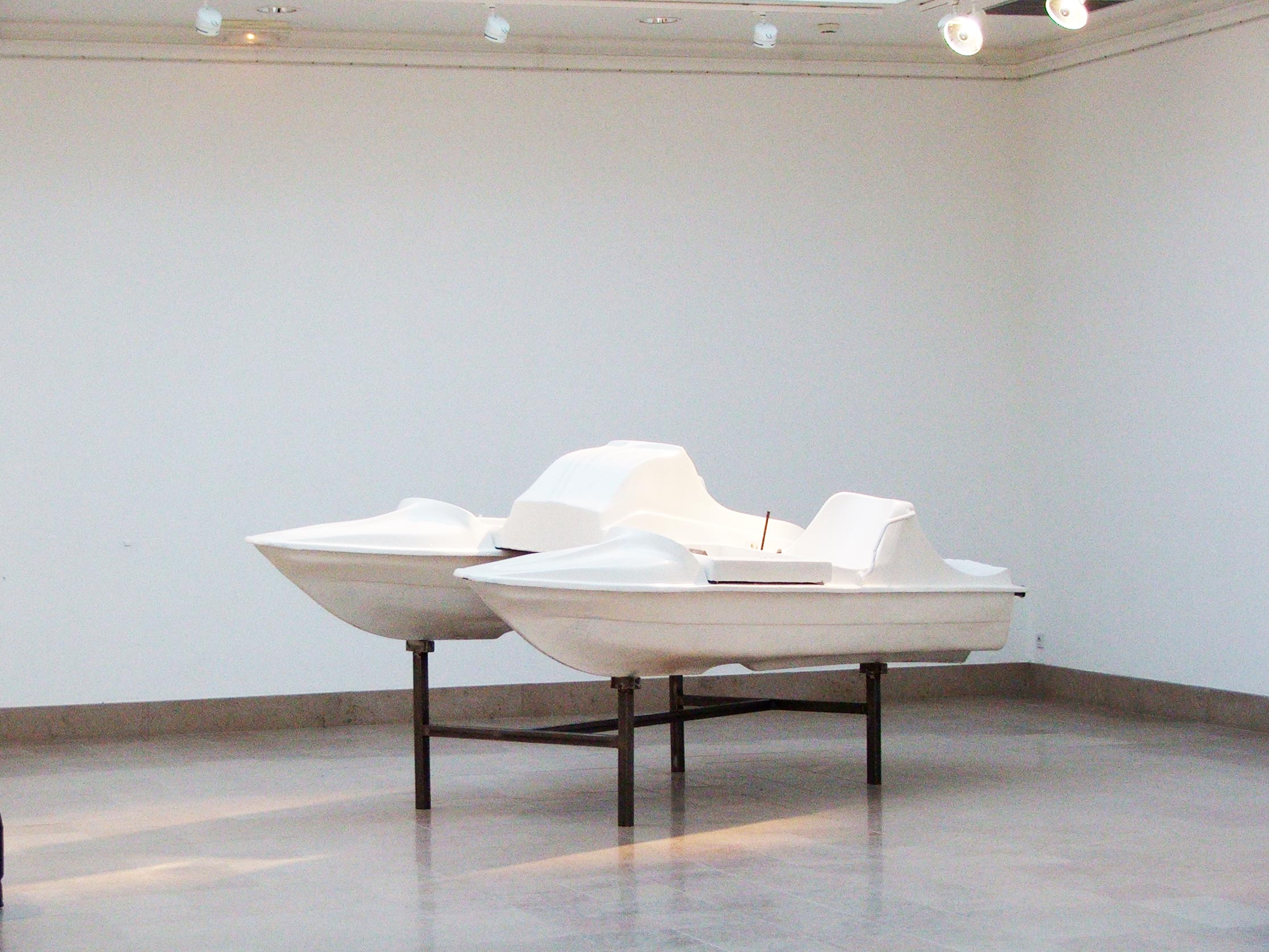(…) Or il se trouve, sans que cela puisse passer pour une coïncidence, que les motifs de ces paysages se caractérisent par une dureté égale – une dureté qui est, à nouveau encore, question de séparation. Liron, vitre regardé, peut passer pour un peintre d’architectures contemporaines. D’architectures sans qualités particulières : à l’exception de la Cité radieuse, les bâtiments qui l’ont retenus jusqu’ici relèvent au mieux du tout venant du logement en série en béton, du siège social banalement néomoderne en aluminium et verre fumé ou du préfabriqué posé sur sa dalle coulée en une journée. Dès lors, il se pourrait que sa préférence pour de tels édifices médiocres ne soit qu’une concession au sociologisme actuel, si tyrannique qu’il n’y a plus guère de jeunes photographes qui ne se croient obligés de s’en aller du côté des grands ensembles, des « quartiers sensibles » et banlieues désolantes des métropoles – sociologisme et misérabilisme pour tirages couleurs. Une deuxième explication se fonderait sur les conditions de vie de l’artiste : pour se rendre à son atelier, il lui faut traverser en voiture l’une de ces zones autour de Lyon où les supermarchés, les entrepôts, les usines, les barres se juxtaposent dans un désordre qu’aucun urbaniste n’a tenté de rendre acceptable – les urbanistes préfèrent intervenir dans les centres historiques, où leurs traces se voient mieux et suscitent des débats. Cet itinéraire pourrait l’avoir inspiré – si ce n’est qu’il travaille ainsi depuis plusieurs années et qu’il serait sans doute plus juste de supposer qu’il s’est décidé pour cet endroit parce qu’il s’accorde à ce qu’il peint – pas des architectures seulement, mais leur rapport avec les lieux.
A mieux y regarder en effet, Liron ne peint pas des immeubles, des tours ou des villas : il peint des constructions dans les champs, des villas entre des arbres et des rochers, une usine dans un pré. Il peint leur intrusion. Il peint l’irruption de leurs volumes anguleux et de leurs murs droits dans ce qui était, auparavant, il y a plus ou moins longtemps, un bois ou une vallée. Des barrières et des grillages découpent l’espace et quelques indices permettent d’imaginer encore à dimi ce qui était là autrefois, avant ces découpages, avant ces séparations. Des plans de béton blanchi ou de brique rouge tombent comme des lames. Des lignes sombres coupent à travers de la toile. Les terrasses écornent le ciel. Les fondations scient la terre. Il y a quelque chose d’inguérissable et d’impardonnable dans ces vues d’aujourd’hui, quelque chose qui fait confondre ces constructions avec des tombeaux et qui rappelle d’anciens souvenirs de peinture, ces paysages du XVIIe siècle bâtis de terrasses, d’escaliers et de pyramides incongrus parmi les rocs et les sources des montagnes. A cette différence près que ceux-ci opposaient le chaos de la nature à l’harmonieuse géométrie humaine alors que, désormais, la monstrueuse géométrie humaine insulte ce qui pourrait rester de désordre quelque part. On n’en sortira pas.
A mieux y regarder en effet, Liron ne peint pas des immeubles, des tours ou des villas : il peint des constructions dans les champs, des villas entre des arbres et des rochers, une usine dans un pré. Il peint leur intrusion. Il peint l’irruption de leurs volumes anguleux et de leurs murs droits dans ce qui était, auparavant, il y a plus ou moins longtemps, un bois ou une vallée. Des barrières et des grillages découpent l’espace et quelques indices permettent d’imaginer encore à dimi ce qui était là autrefois, avant ces découpages, avant ces séparations. Des plans de béton blanchi ou de brique rouge tombent comme des lames. Des lignes sombres coupent à travers de la toile. Les terrasses écornent le ciel. Les fondations scient la terre. Il y a quelque chose d’inguérissable et d’impardonnable dans ces vues d’aujourd’hui, quelque chose qui fait confondre ces constructions avec des tombeaux et qui rappelle d’anciens souvenirs de peinture, ces paysages du XVIIe siècle bâtis de terrasses, d’escaliers et de pyramides incongrus parmi les rocs et les sources des montagnes. A cette différence près que ceux-ci opposaient le chaos de la nature à l’harmonieuse géométrie humaine alors que, désormais, la monstrueuse géométrie humaine insulte ce qui pourrait rester de désordre quelque part. On n’en sortira pas.
Extrait de la préface de Philippe Dagen.