« Quand le train est en marche, tout se brouille ; quand il s’arrête, on distingue le paysage. Sauf que le paysage ressemble au panorama des attractions du premier XXe siècle ».
On ne peint pas les choses, écrit à peu de choses près Mallarmé, mais leur écho ou leur reflet en nous. Et on aura peine à trouver l’objectivité d’un portrait synthétique dans chacun de ces courts textes qu’un nom pourtant introduit. D’ailleurs le recueil que livre Jacques Sicard n’est pas titré « 80 portraits », mais, sur quatre lignes, jouant incidemment d’une ambiguïté de lecture, « Photogramme Arrêté, Portrait de Jacques Sicard ». Et cela tient effectivement de l’objet cinématographique, ou d’un objet requis par la matière cinématographique, d’arrêt sur images ou sur des images-moments (le photogramme est précisément cet objet insaisissable dans le film projeté, paradoxal, à cheval sur deux mondes), et, d’une forme d’autoportrait détourné, que l’on pourrait légender par une formule de l’historien des images et philosophe Georges Didi-Huberman : « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde ». Polysémie de ce dernier terme comprise.
A travers ces portraits, donc, qui n’en sont pas, se laisse deviner l’attention passionnée de Jacques Sicard pour le cinéma, ses amitiés poétiques et politiques, les détours et les façons de sa propre pensée poétique, suscitée souvent par des associations furtives, des jeux d’échos, de renvois, de comparaisons. Ainsi, ces quelques 80 fragments, réflexions, poèmes en prose, semblent prélevés à la matière mentale et sensible, comme des plans pourraient enregistrer les mouvements du regard, et un dictaphone mental, saisir les pensées à l’œuvre dans les plis, les gestes, qui font les phrases de nos vies. On penserait à un journal. De ceux dans lesquels tombent les jours. Comme les agendas de Bonnard témoignent de ses attentions, à la lumière, au temps, à quelques silhouettes prenant forme dans le crayonné de l’œil.
Des textes courts, donc, mais à fortes résonances, fortes intrications, que l’on n’en finit pas de déplier en soi, d’entendre. A la manière d’un gong qu’on frappe, on suit les vibrations qu’ils diffusent, qui se perdent loin dans la matière de la vie courante. A-t-on jamais tout à fait compris ? Tout est-il seulement saisissable ? Mais d’un clin d’œil nous avons vu. Nous avons suivi la courbe d’un geste qui allait s’évanouir. De ces gestes dont on ne sait jamais bien s’ils ont lieu dans l’espace atmosphérique de la vue ou dans celui qui, sous forme de songes, de fictions, s’apparente à un cinéma intérieur.
Une certaine liberté de ton et de forme, des ellipses, des renvois, un mouvement enfin, tantôt relevant de la cascade ou de l’esprit d’escalier, tantôt du ricochet ou de grandes enjambées, pourraient évoquer un certain état d’esprit dans lequel Breton rédigeait ses livres. S’y trouvent des formules, parfois lapidaires, dont on ne sait vraiment si elles vous éclairent ou vous précipitent à l’envers dans une sorte de dédale obscur en lequel la pensée s’inquiète. Des élans, des portraits en gigogne. Des points. Point sur la situation, point de vocabulaire, point du jour… « Que préférez-vous : un travelling le long d’une rue aux murs graffités par des ombres baïonnette au canon se déplaçant à la vitesse de la lumière ou calqué sur le lent déplacement de la femme japonaise entravée par sa parure, maltraitée par le récit, mais aimée par la forme ? Je voudrais les deux. » Tout comme nous voudrions le train en marche et le train arrêté, la parole et le silence, l’image et le texte, le cinéma dans son illusion et les photogrammes qu’on en extrait.
Ainsi le livre se construit sur ces mouvements multiples, intriqués, semblables à ces thèmes qui traversent une partition, sous une forme parfois retournée, fragmentaire, produisant un motif et le fondant dans une phrase qui l’intègre et le dépasse.
Avec une acuité singulière, qui n’est pas sans évoquer celle dont fait preuve un autre écrivain familier de le matière cinématographique, de sa grammaire et de ses multiples dimensions — Eric Rondepierre —, Jacques Sicard évoque alors la notion de cinème, « ce réseau relationnel, invisible mais sensible et pensable, sans quoi il n’est pas de photogramme ». Élément de liaison, élément passeur, discret dans les deux sens du terme, sur lequel tout récit, toute lecture, c’est-à-dire toute fabrique de sens, s’appuie. Cinème dont l’auteur confesse qu’il est son « économie domestique ». Une des façons qu’a le cinéma de hanter, d’infuser son écriture. Un déclencheur et point d’appui. Une façon d’articuler saisie et mouvement en nous restituant cette intranquillité qui pousse ces textes dont on ne sait plus dire la nature tellement elle est composite, métissée, accueillante : poèmes, pensées, songes, méditations philosophiques (pas du philosophe : « Qu’il attrape le cancer et revienne nous parler du libre-arbitre. »), cartes postales… Une manière aussi de faire « bande », de dresser la liste des compagnons dans cette drôle de Commune à quoi ressemble l’époque.
Avec ce livre (j’avais tapé « libre »), il fournit en tout cas une sorte de vade-mecum poétique éthique, une arme « offensive – défensive », comme Picasso envisageait, disait-il, sa peinture. Une matière à penser en dehors, à côté ou à travers la matière du monde, cette curieuse projection qui émane de nous et nous contiens.
Jacques Sicard, Photogramme arrêté, tarmac éditions, 2022.
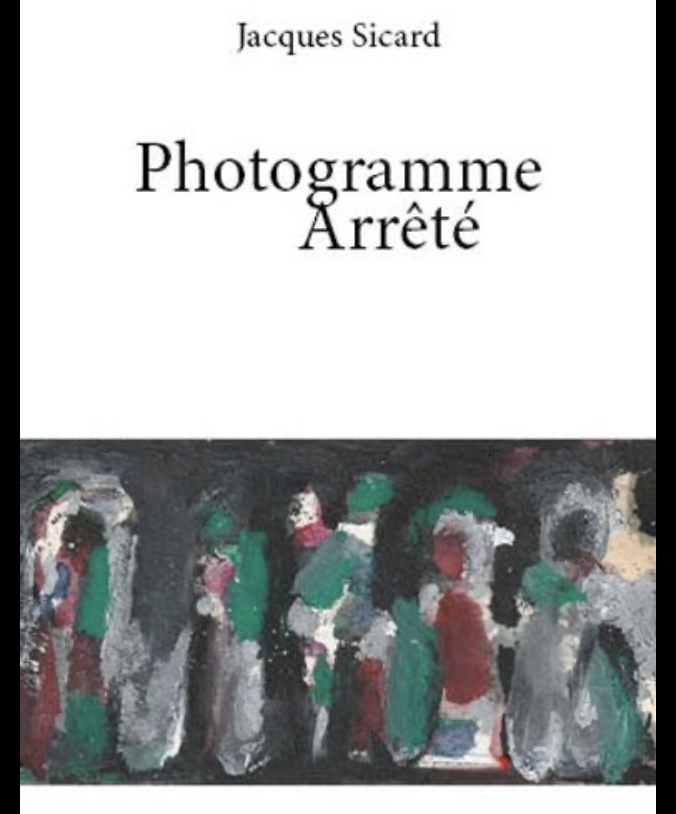
Merci pour l’amitié sensible, la compréhension simple (comme il est un enchantement simple) de ce texte.
Jacques Sicard