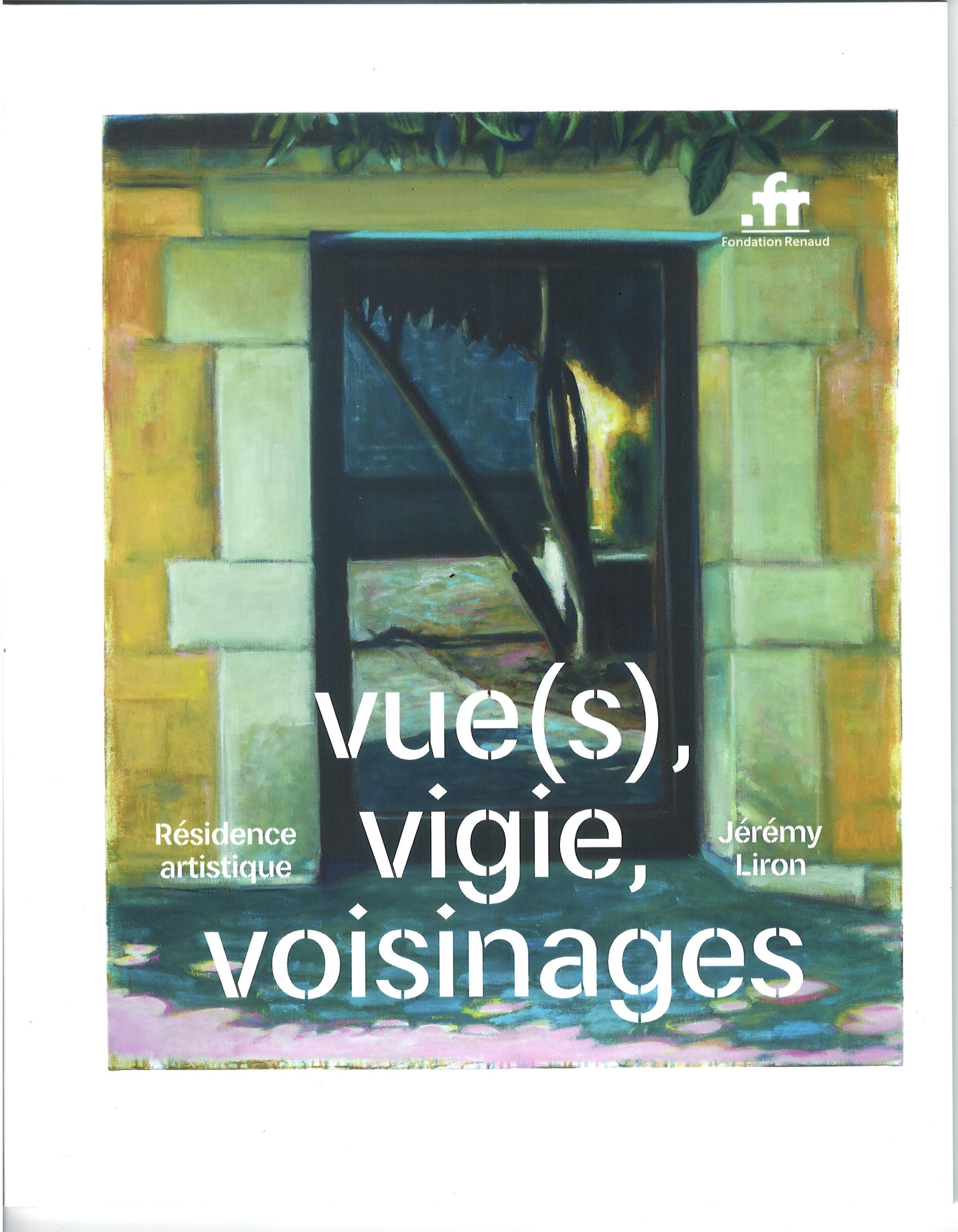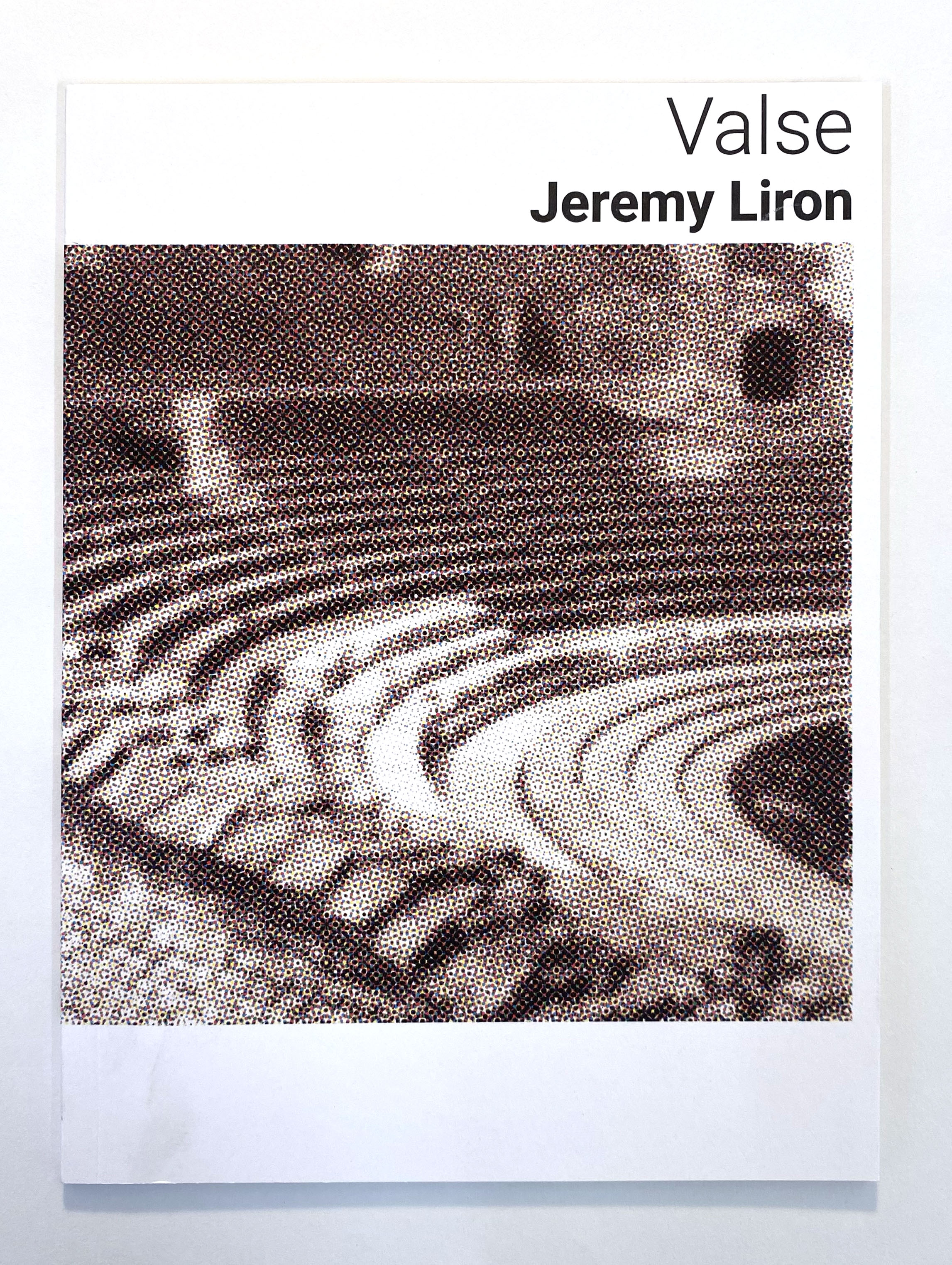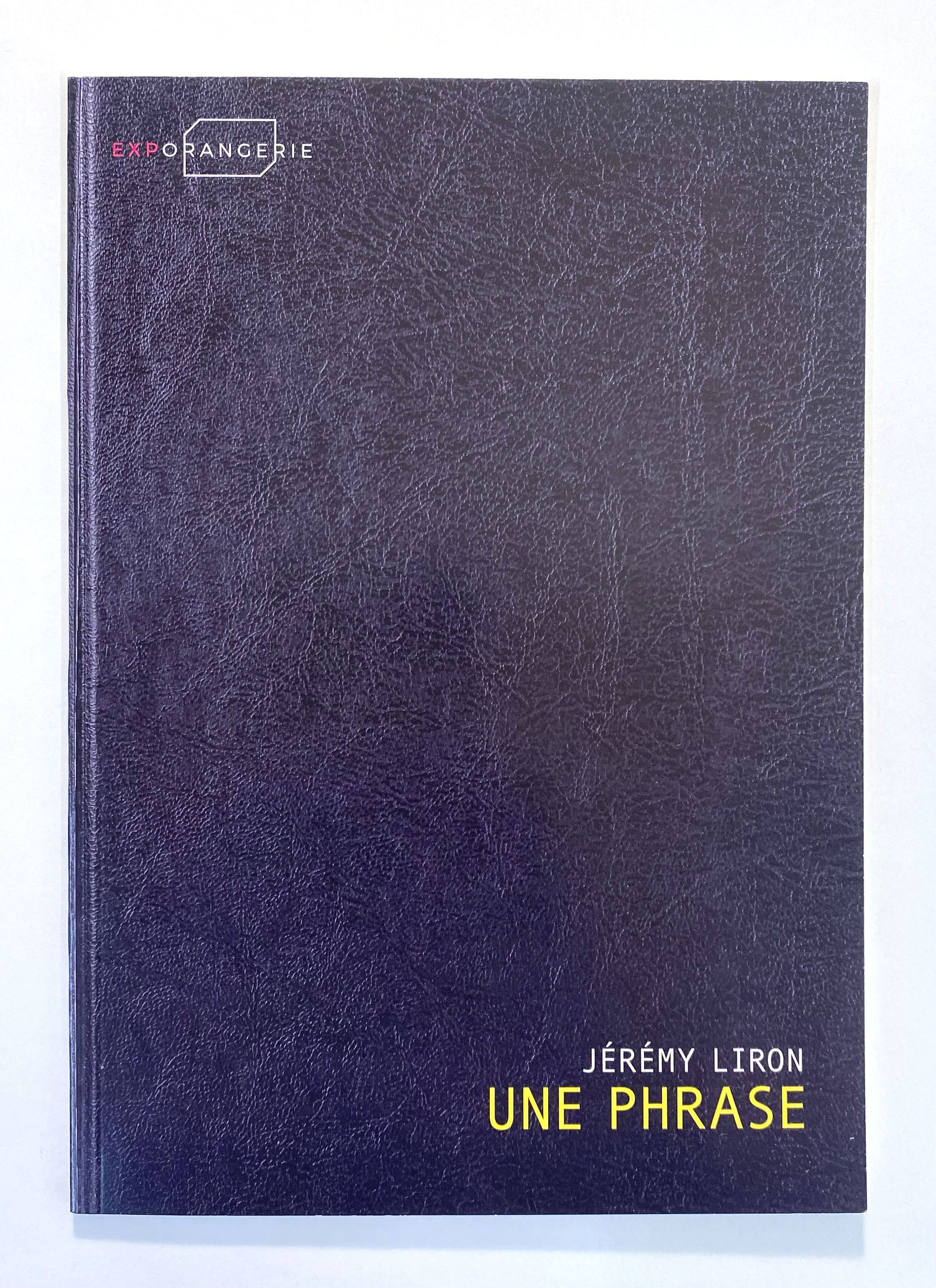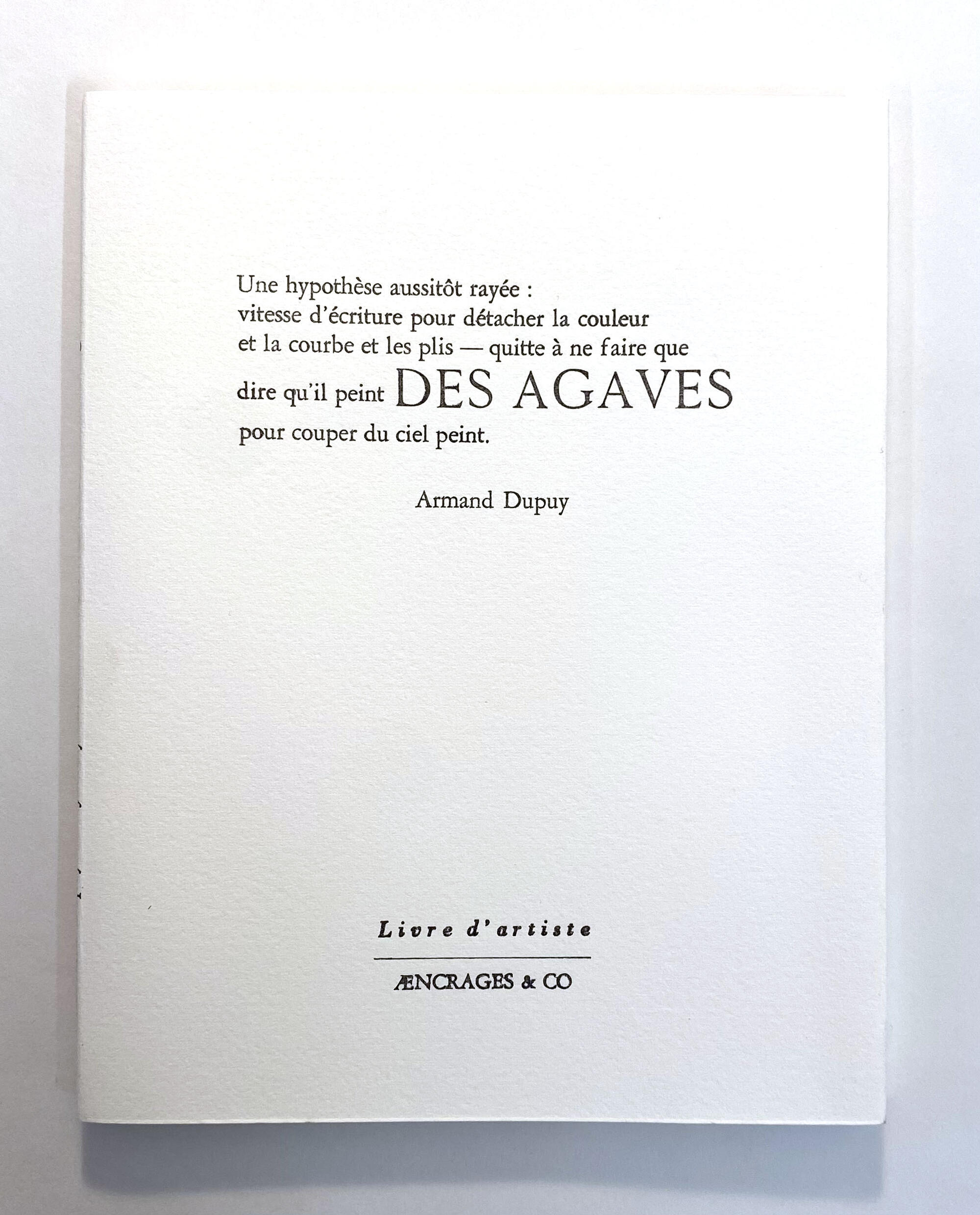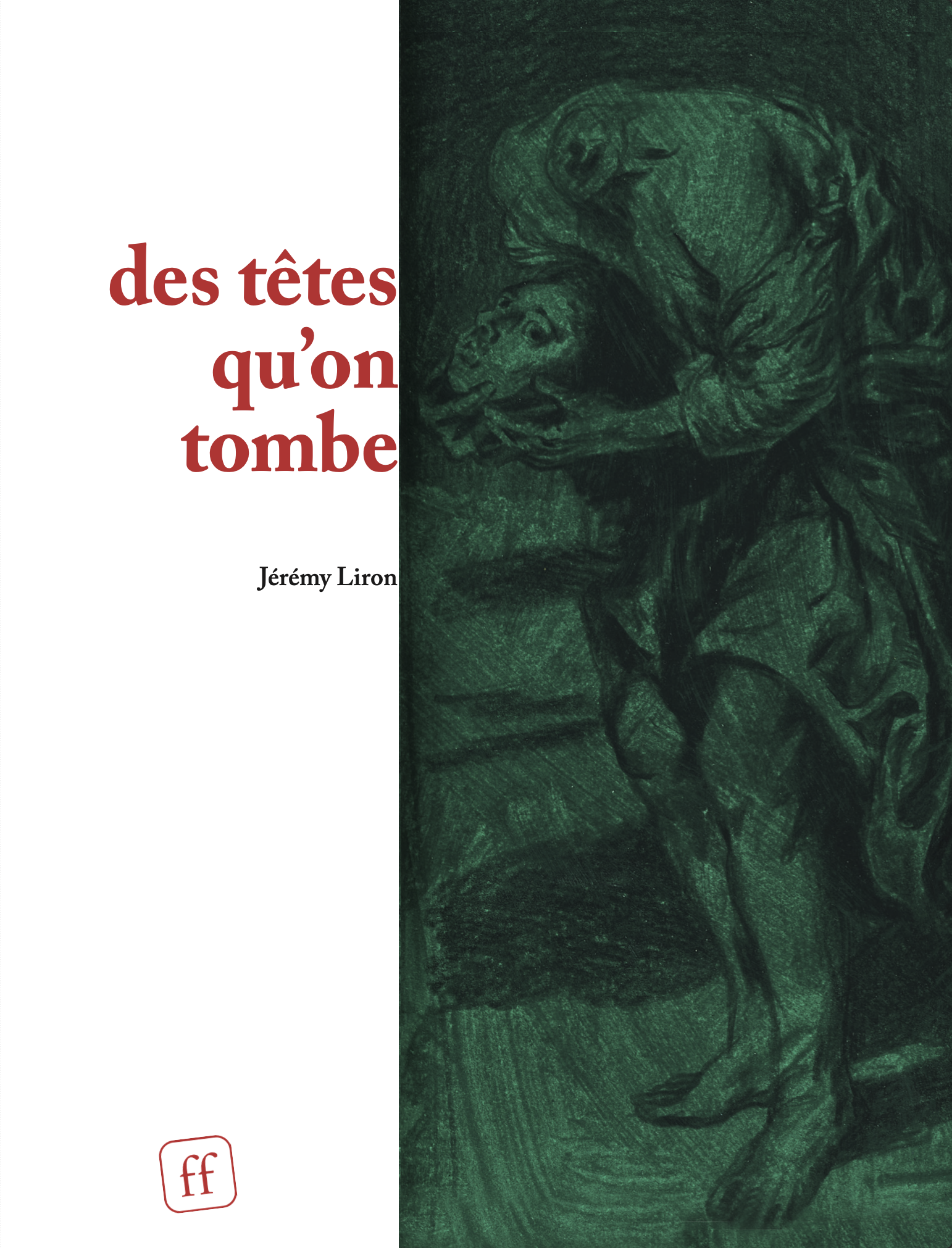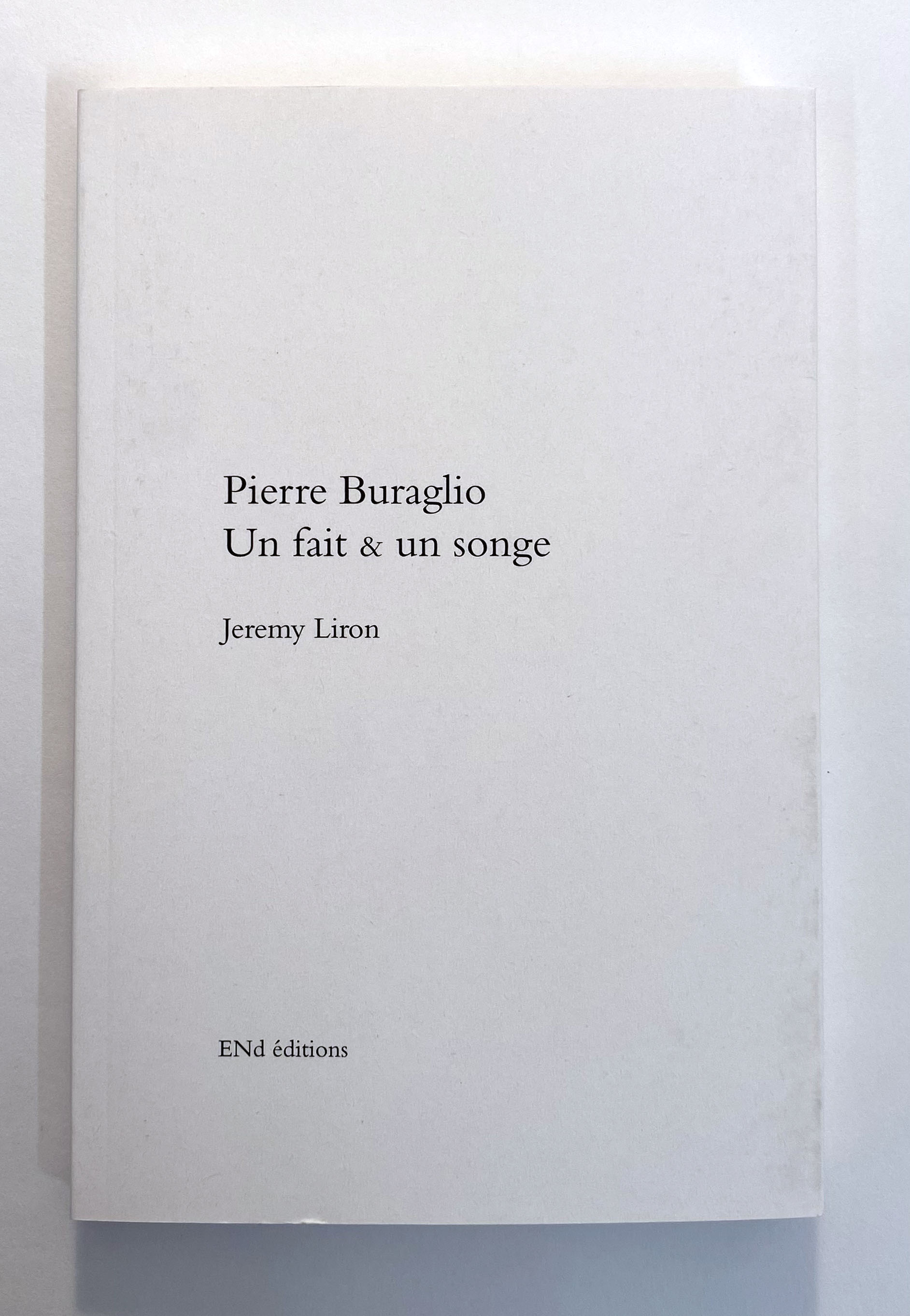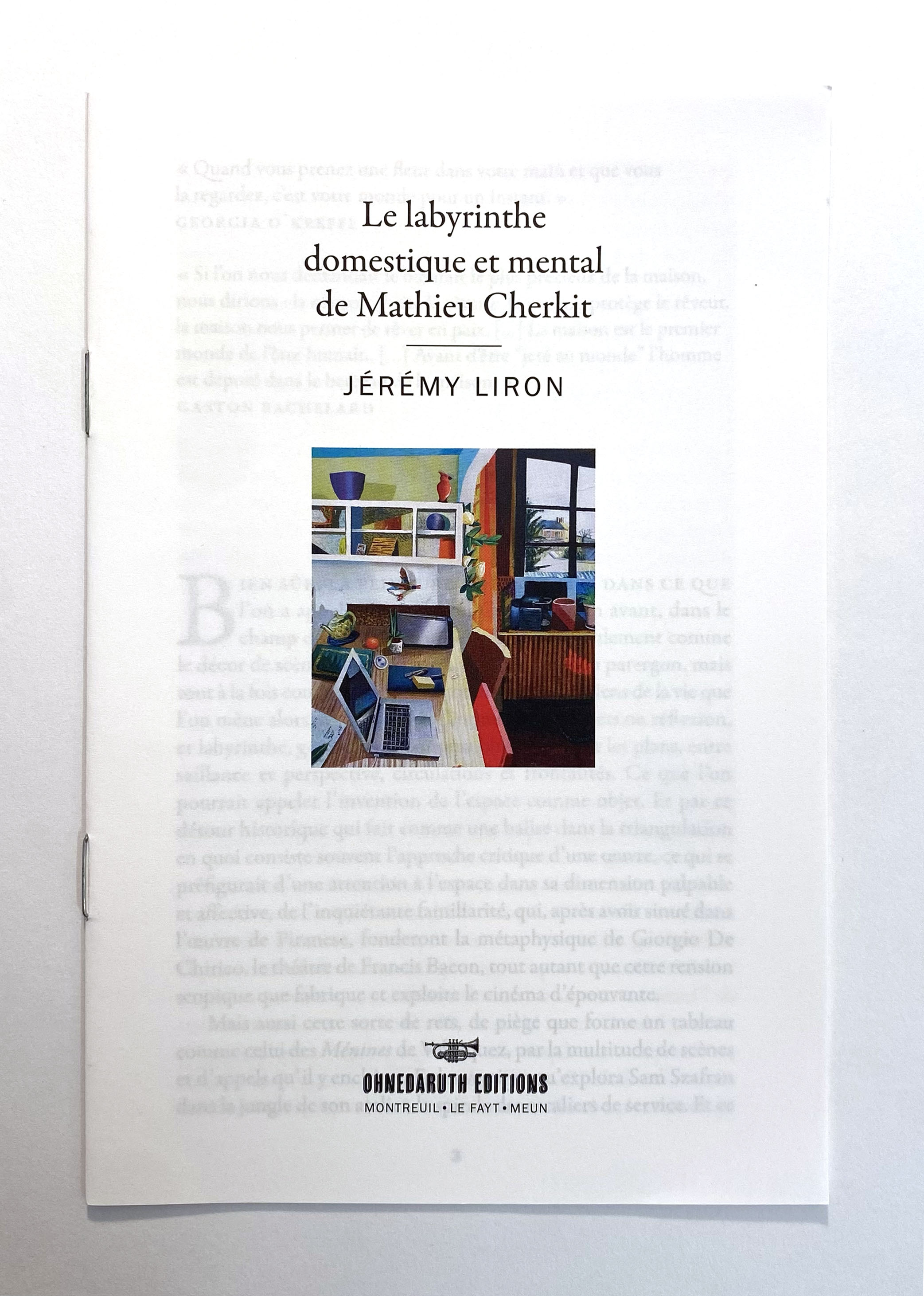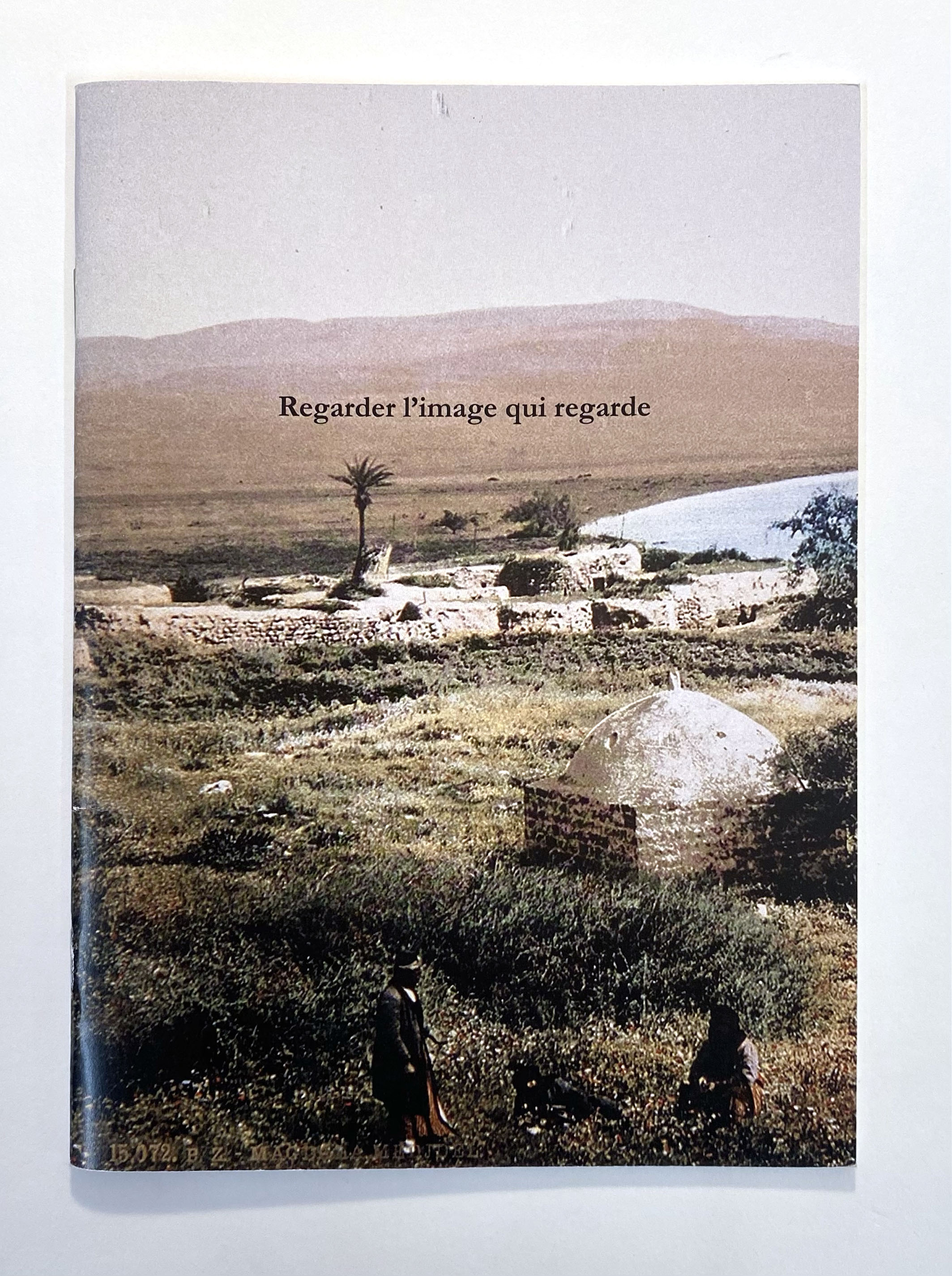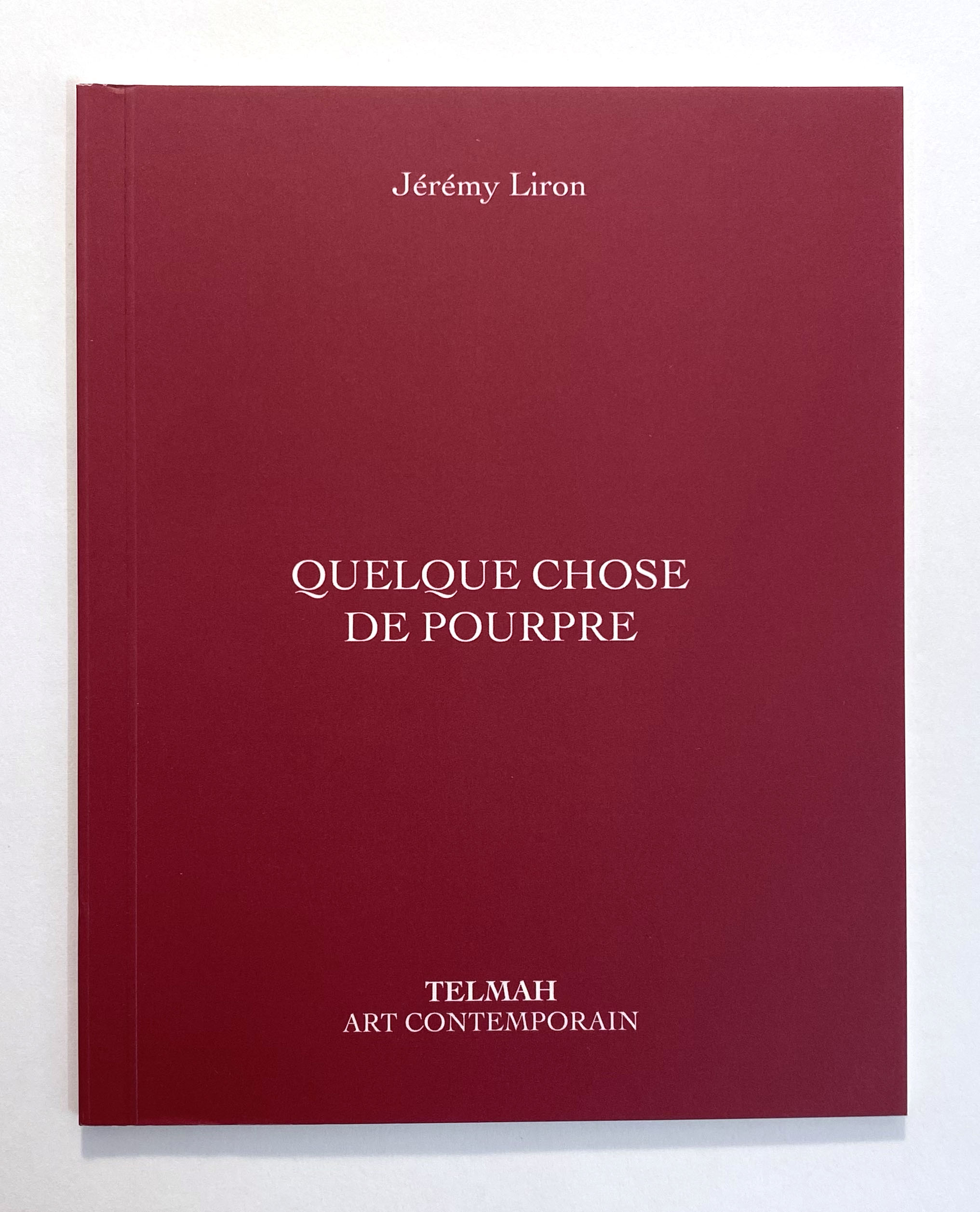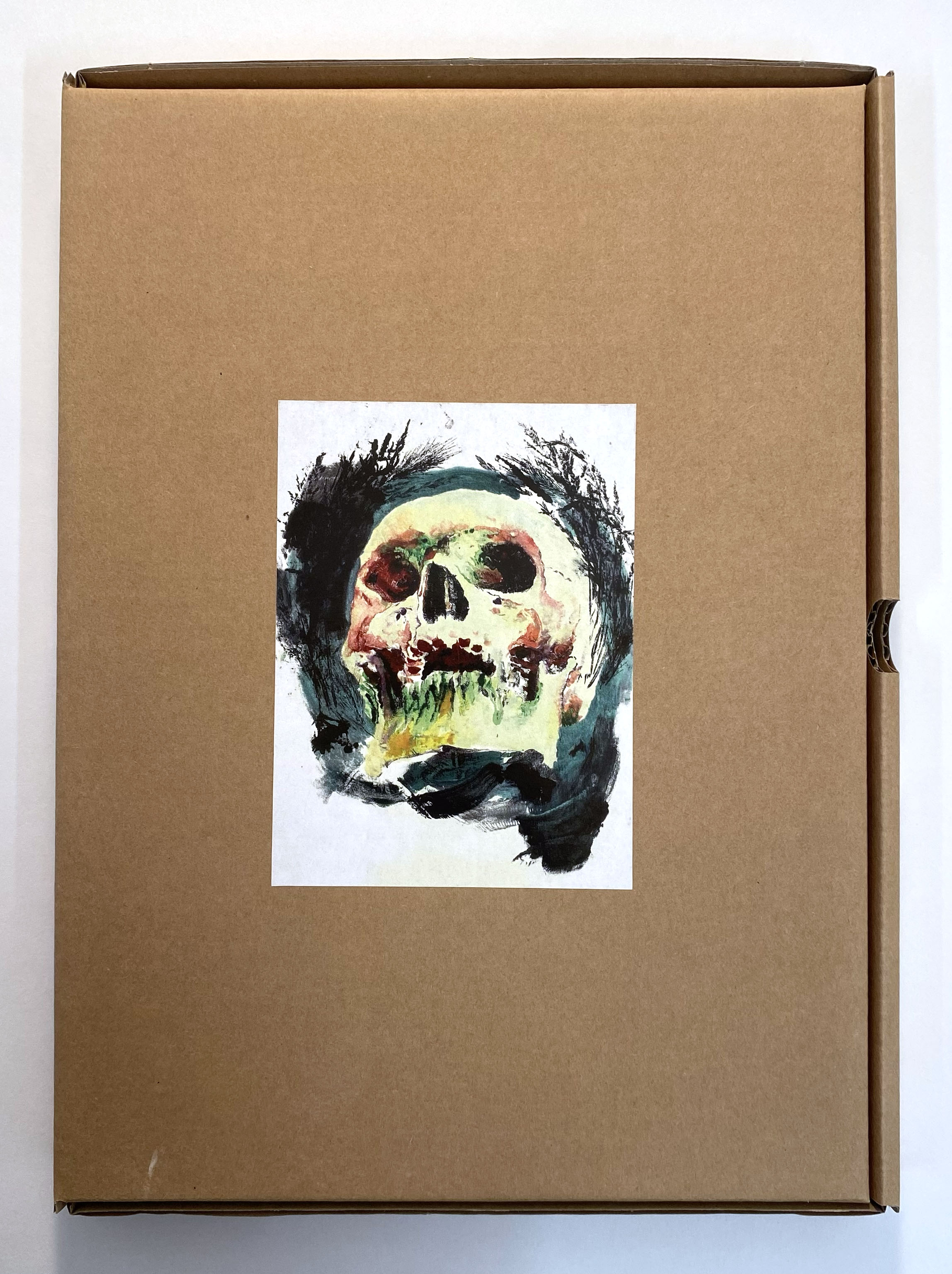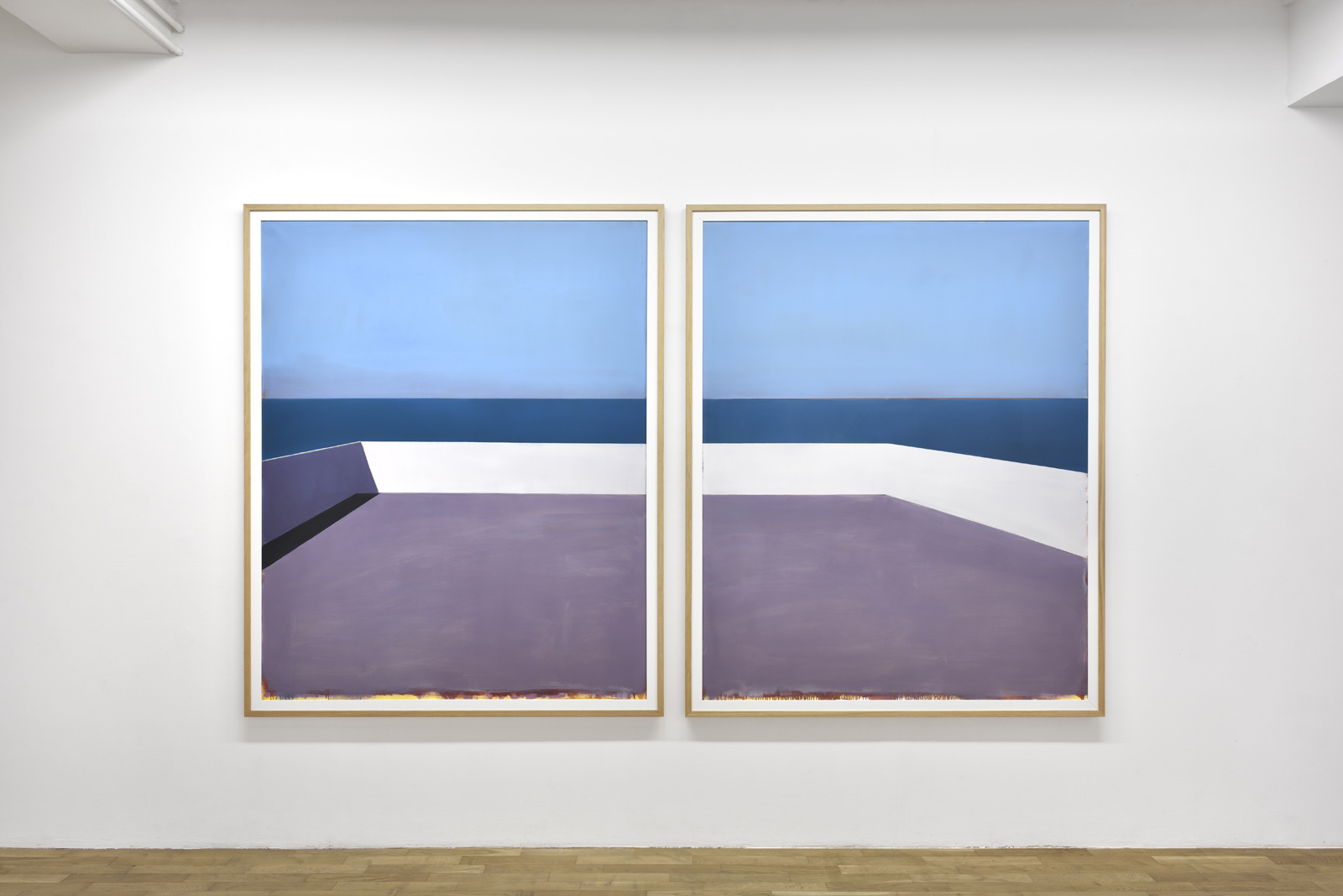Filtres
Filtres
- Paysages
- Petits Paysages
- Tentatives d'épuisement
- Images inquiètes
- Archives du désastre
- Dessins
- Caro
- Sculptures
- Habiter
- Peintures confinées
- Agaves
- Architecture
- Cyprès
- Falaises
- Fenêtre
- Figuier de barbarie
- Figuiers
- Grille
- Le Corbusier
- Malaparte
- Mer
- Mur
- Ombres
- Pins
- Plantes
- rose
- Sculpture
- Terrasse
- Polyptyque